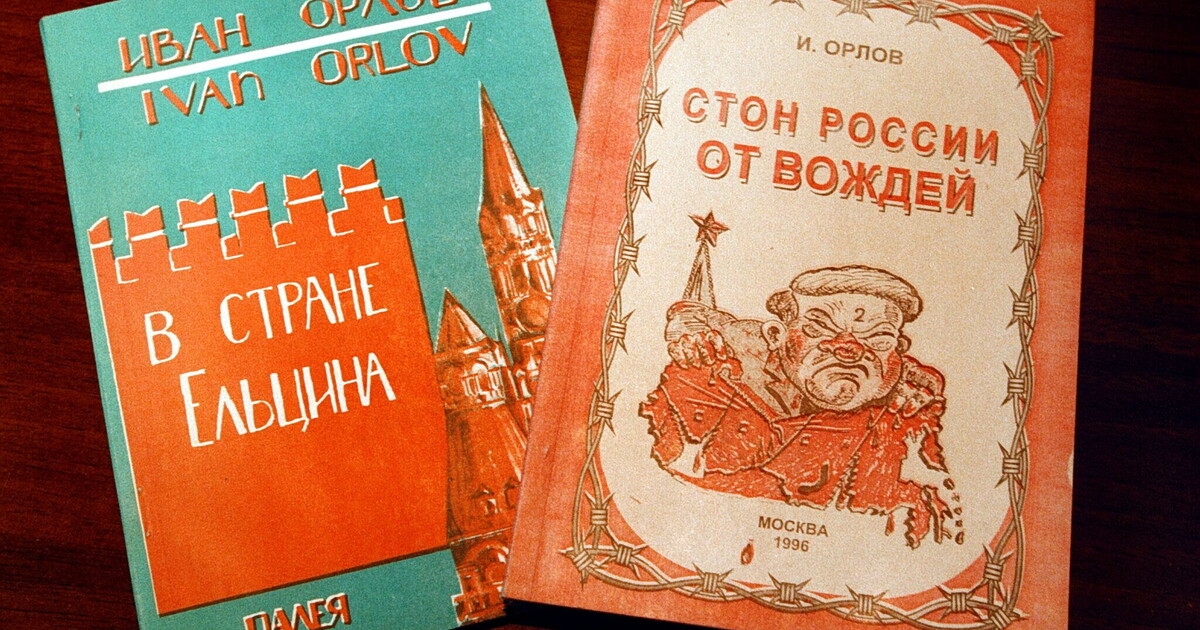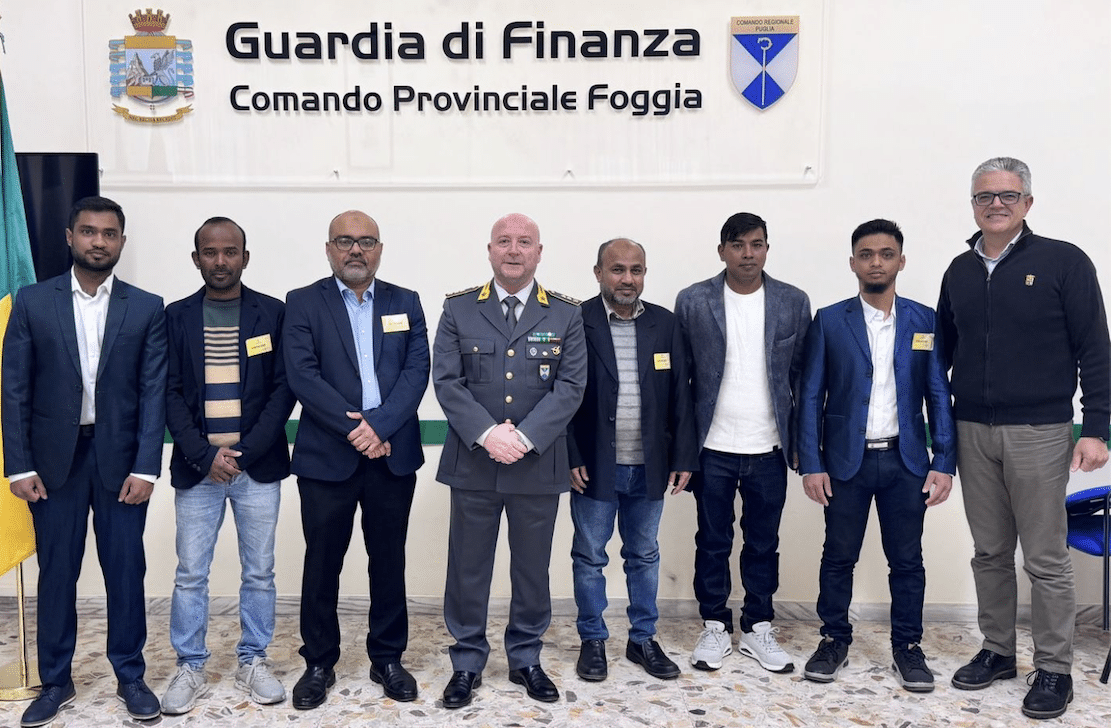« La mort de Jus Belli » : Cacciari tire la sonnette d'alarme à la Biennale

« Rien ne redevient comme avant quand on a mis à mort les principes fondamentaux de sa culture. » C’est par cette phrase, prononcée d’un ton grave et lucide, que Massimo Cacciari s’exprimait ce soir à la Biennale de Venise, lors d’une de ses conférences les plus percutantes et prophétiques, intitulée « La Mort du Jus Belli. Guerres et Paix ». Présenté par le président de la Biennale de Venise, Pietrangelo Buttafuoco, qui inaugurait ce nouvel événement de la Biennale della Parola, et salué par le patriarche de Venise, Monseigneur Francesco Moraglia, le philosophe a entrelacé les réflexions d’Emmanuel Kant (« Pour la paix perpétuelle ») et d’Ernst Jünger (« La Paix – Un mot à la jeunesse d’Europe et à la jeunesse du monde ») dans un discours qui tenait à la fois de l’analyse politique, du diagnostic moral et de l’appel civique.
La thèse de Cacciari est claire : la guerre actuelle a effacé toute distinction entre militaires et civils, entre légal et illégal, entre guerre et extermination. « Le droit de la guerre n’existe plus. Là où sont les militaires, il y a la population civile. Et ensemble, ils sont l’ennemi. C’est une guerre absolue, une guerre d’extermination », a déclaré Cacciari.
Le philosophe vénitien a dénoncé une transformation radicale du conflit, marquant une rupture historique avec tous les précédents. Si, par le passé, même les guerres les plus féroces reconnaissaient, au moins formellement, des limites et des règles, aujourd'hui – affirme Cacciari – ce fragile rempart s'est entièrement effondré. Nous ne combattons plus des armées, mais des peuples entiers ; non plus des adversaires politiques, mais leur existence même. D'où la question fondamentale : qu'advient-il du droit international, du « droit à la paix », lorsque la guerre devient absolue ?
Pour Cacciari, l'Europe perd ses racines juridiques et morales, s'illusionnant sur le fait que tout peut redevenir comme avant, une fois « l'ennemi éliminé ». Mais ce faisant, prévient-il, « non seulement le droit, mais la civilisation européenne elle-même s'effondre ».
L’ultime recours est confié aux nouvelles générations. Il leur appartiendra, a déclaré Cacciari, de tenter de reconstruire un tissu humain, social et culturel capable de rétablir le droit international. « La tâche semble presque impossible, mais elle est indispensable. Les générations passées et présentes ont échoué : seul un diagnostic rigoureux peut faire renaître l’espoir. »
Et cet espoir, admet le philosophe, n'est pas de notre temps : « L'espoir réside au-delà d'aujourd'hui, au-delà des montagnes les plus infranchissables. Mais sans lui, sans la conscience de ce que nous avons détruit, aucune paix ne peut naître. » Avec « La Mort du Jus Belli », Cacciari ne se contente pas de commenter la chronique des guerres contemporaines – de Gaza à l'Ukraine – mais interroge la conscience même de l'Europe, sa foi dans le droit, dans la raison, dans la distinction entre humanité et barbarie. Un avertissement qui sonne comme une sentence, mais aussi comme un ultime appel : « repensez au droit » avant qu'il ne soit trop tard.
En inaugurant l'événement, le président Buttafuoco a souligné que la Biennale de Venise devait être un laboratoire de la liberté d'expression, un rempart contre la censure de sujets aujourd'hui quasi tabous dans le débat public, tels que la guerre et la paix. Il a ensuite évoqué avec nostalgie l'intellectuel catholique Giorgio La Pira et le parlementaire communiste Pio La Torre, deux figures emblématiques d'une Italie qui a su conjuguer foi et engagement civique, dialogue et confrontation. « Je me souviens de l'Italie de La Pira, qui rassemblait à Florence des ennemis du monde entier pour parler de paix, et de l'Italie de Comiso, avec Pio La Torre et des millions de personnes mobilisées. Aujourd'hui, de telles personnalités seraient traitées comme des ennemis publics, privées du droit à la parole. »
Ce passage sonne comme une critique acerbe du débat contemporain clos, où la complexité et la discussion semblent avoir cédé la place à la simplification et à l'intolérance. C'est pourquoi Buttafuoco a réaffirmé la mission de la Biennale : sauvegarder la liberté de pensée et défendre la parole comme outil de connaissance, et non de propagande. « La Biennale œuvre pour la parole », a-t-il déclaré, « et nous sommes fiers de ce que nous accomplissons chaque jour dans notre travail. »
En cette période marquée par les guerres et les tensions internationales, le patriarche de Venise, Monseigneur Francesco Moraglia, a offert une profonde réflexion sur le thème de la paix et de la guerre avant la conférence de Cacciari, nous invitant à dépasser le cadre politique et institutionnel pour redécouvrir la dimension spirituelle et morale de la paix. Moraglia a rappelé combien le monde actuel est « dominé par l'expansionnisme et les nouvelles technosciences appliquées jusque dans l'industrie de l'armement ». Face à ce constat, le patriarche a évoqué la pertinence du projet de Kant exposé dans son traité « La Paix perpétuelle », où le philosophe allemand envisageait la création d'un corps juridique international capable de mettre fin aux conflits par la force du droit. Mais la réflexion de Moraglia ne s'est pas arrêtée à la théorie. « On peut avoir les meilleures lois et les meilleurs instruments, mais sans pilote, le voyage ne peut être mené à terme », a-t-il observé, faisant allusion à la crise des organisations internationales comme les Nations Unies et au manque de volonté politique et morale qui empêche la paix de s'enraciner. Dans son discours, le patriarche a également évoqué la notion de « structures du péché », ces réalités et dynamiques sociales qui perpétuent l'injustice et la violence, souvent sous d'autres appellations. La guerre, a-t-il affirmé, « n'est pas toujours appelée guerre, mais se poursuit sous d'autres formes ». Le cœur du message de Moraglia est cependant d'ordre anthropologique : la paix ne naît pas des lois, mais du cœur humain. Citant le philosophe russe Nikolaï Berdiaev, il a rappelé que « la vérité chrétienne présuppose la liberté » et que le mal n'est pas vaincu par la force de l'État, mais par une victoire intérieure et spirituelle. « L'État peut limiter la violence, mais il ne peut éradiquer le péché », a-t-il ajouté. Moraglia a conclu par un appel à la responsabilité personnelle et collective : « Le bien n'est pas le fruit des seules lois, mais de la liberté qui choisit le bien. Nous devons repartir de l'humanité, de sa complexité, de ses blessures et de sa capacité de renouveau. » Seule une humanité réconciliée avec elle-même, a-t-il ajouté, pourra trouver « la grâce de vivre dans la vérité et de bâtir une paix authentique ». (par Paolo Martini)
Adnkronos International (AKI)